Frédéric Roels « revisite » sa production rouennaise, passée ensuite par la version cinématographique de 2021… Et Don Giovanni enflamme le public à l’Opéra Grand Avignon

Vendredi 10 octobre 2025, 20h ; dimanche 12 octobre, 15h ; mardi 14 octobre, 20h. Durée 3h. Opéra Grand Avignon (site officiel)
Don Giovanni, dramma giocoso en 2 actes de Wolfgang Amadeus Mozart (1787), livret de Lorenzo da Ponte. Production Opéra Grand Avignon. Chanté en italien, sous-titré en français.
Direction musicale Débora Waldman. Chef de Chœur Alan Woodbridge. Mise en scène Frédéric Roels. Scénographie Bruno de Lavenère. Costumes Lionel Lesire. Lumières Laurent Castaingt. Assistante à la mise en scène Nathalie Gendrot. Études musicales et basse continue Juliette Sabbah
Don Giovanni Armando Noguera. Donna Anna Gabrielle Philiponet. Don Ottavio Lianghua Gong. Il Commendatore Mischa Schelomianski. Donna Elvira Anaïk Morel. Leporello Tomislav Lavoie. Masetto Aimery Lefèvre. Zerlina Eduarda Melo
Figurants Helena Vautrin, Cyril Boussin, Laurent Dallias, Jean-Paul Fernay, Julien Florès
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Orchestre national Avignon-Provence
![]()
Retransmission sur écran géant
Voir aussi toute la saison 2025-2026, « Mythes », à l’Opéra Grand Avignon

NOTRE ANNONCE
L’Opéra Grand Avignon – qui fête son bicentenaire – joue la carte de l’ouverture au plus large public pour son début de saison opératique. Choisir le Don Giovanni de Mozart, c’est programmer un immense succès du répertoire. La distribution fait rêver, avec en tête le baryton français d’origine argentine Armando Noguera, œil de velours et sourire gourmand ; sa brillantissime carrière internationale ne l’empêche pas de revenir une fois encore en Vaucluse, après la grande fête de célébration des 50 ans de carrière de Raymond Duffaut, le 26 juillet 2024 à Gordes, ou les Voix solidaires 3 en 2023, ou Voix solidaires 2 en 2022, ou Turandot à Marseille en 2019, ou Musiques en fête aux Chorégies… entre autres…
Frédéric Roels – tout à la fois directeur de l’Opéra, scénariste et metteur en scène -, reprenant partiellement sa production de Rouen et Versailles, avait déjà monté un excellent Don Giovanni [le film] pendant le confinement dans l’Opéra Grand Avignon alors en rénovation, et nous l’avions interviewé à cette occasion, après un entretien en pleine pandémie et avant Peter Grimes ; hors Don Giovanni et le Commandeur, il en reconduit la distribution, comprenant aussi l’Orchestre et le Chœur, sous la direction de Debora Waldman – pour sa dernière saison à Avignon – ; nous l’avions vu à Confluence puis sur France3 : l’interprétation très personnelle du metteur en scène, d’une « grande bousculade », d’un opéra mené par les figues féminines et où Don Giovanni n’est auréolé que d’un éclat factice, est séduisante.

Le public aura un très large accès à cette œuvre majeure : après la répétition publique et l’atelier de chant du vendredi 3 octobre, il pourra s’immerger gratuitement pour 1h dans les coulisses, les vendredi 10 et mardi 14 octobre à 18h45, pour les détenteurs de billets pour la représentation du soir. Il suffit de réserver sur le site.
Mieux encore : on pourra assister gratuitement à la première représentation, diffusée en direct sur grand écran le vendredi 10 octobre à 20h15, place St Didier à Avignon, bien installé sur les transats et sous les couvertures (fournis par le Grand Avignon), et simultanément dans la salle de l’Autre Scène de Vedène.
G.ad. Photos Mickaël & Cédric/ Studio Delestrade/ Avignon
![]()
NOTRE COMPTE RENDU
Don Giovanni enflamme le public à l’Opéra Grand Avignon

Le public en liesse au sortir d’un spectacle de trois heures, applaudit à tout rompre dans la salle de l’opéra à l’italienne de la place de l’Horloge. Pour ouvrir la saison Mythes 2025-2026 de l’Opéra Grand Avignon, Frédéric Roels, son directeur, a repris sa mise en scène de Don Giovanni, l’opéra en deux actes, écrit en 1787 par le compositeur autrichien de génie, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Retransmis en direct sur écran géant, place Saint-Didier au centre-ville d’Avignon, et à L’Autre Scène de Vedène, vendredi 10 octobre, ce « dramma giocoso » (genre d’opéra burlesque né en Italie au XVIIIe siècle) ouvrait aussi la riche programmation 2025-2026, visant à célébrer le Bicentenaire de l’Opéra Grand Avignon, haut-lieu de création, de transmission et de rayonnement culturel depuis 1825.
L’Orchestre National Avignon Provence, dirigé par la cheffe Débora Waldman, lance la danse en enchaînant le grave andante, le vif allegro et la coda transitoire de l’ouverture, en alliant justesse, force et puissance. Le rideau s’ouvre sur un décor intemporel, évoquant par les hautes façades de ses immeubles de guingois, les villes italiennes. Ici, les murs se fendillent, penchent dangereusement vers l’avant et menacent de s’écrouler, s’il n’y avait ces étais pour les soutenir. Un effondrement qui reflète la chute de notre anti-héros, Don Giovanni, ce bourreau des cœurs sans cœur, dénué de tout scrupule et de tout remords.
Interprété tout en nuances par le séduisant baryton argentin Armando Noguera, qui joue sur toutes les cordes de son charme latino-américain, pour séduire le public – qui le connaît bien – et les femmes de l’histoire, Don Giovanni inspire tout autant le dégoût que la pitié. C’est à son serviteur, Leporello, que revient le rôle de « louer » ses conquêtes, ces fameuses « Mille e tre », dont son maître lui fait parfois profiter… Brillamment incarné par Tomislav Lavoie (qui avait fait ses débuts dans le rôle de Masetto et que nous avions entendu en Sarastro pour les fêtes de fin d’année 2019 sur cette même scène dans La Flûte d’Hervé Niquet -), à la voix de basse ronde et enveloppante, il joue sur tous les registres de la comédie à la tragédie, entraînant le public dans une histoire pleine de piquant et de rebondissements.

Mais ici, ce sont les femmes qui mènent la danse ! Trois sopranos à la voix cristalline, avec une mention spéciale pour Zerlina, exquise Eduarda Melo – elle aussi déjà accueillie en terre vauclusienne -, espiègle séductrice et habile manipulatrice, qui tire les ficelles et se joue de son fiancé Masetto. Mais Anaïk Morel (une Donna Elvira éconduite mais fidèle) – que nous avons entendue en Carmen à Toulon en 2023 – et Gabrielle Philiponet (la fille du Commandeur Donna Anna qui n’a pas dit son dernier mot) – qui incarnait Mimi ici même au printemps – ne déméritent en rien à la qualité de l’œuvre. Dans leurs costumes chamarrés, les chanteurs du Chœur de l’Opéra, qui accompagnent les soli pour les noces de Masetto et Zerlina, colorent cette inexorable descente aux enfers, jusqu’à la fatale sentence du Commandeur, un Mischa Schelomianski – entendu à Avignon dans Luisa Miller en 2024 et le Chevalier à la rose en 2022, ainsi qu’à Aix-en-Provence dans Le Coq d’or en 2021 – en implacable justicier à la voix grave, sortie tout droit des profondeurs de la Terre.
Enlevée, colorée, joyeuse et résolument moderne, la mise en scène de Frédéric Roels souffle un air de renouveau sur le chef-d’œuvre de Mozart et captive son auditoire. Quel délicieux moment et quelle magnifique ouverture de saison !
M.-F.A. Photos Mickaël & Cédric/ Studio Delestrade/ Avignon
![]()
NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCENE
Il y a là-dedans, comment dire, une grande bousculade. Bousculade d’époques, bousculade de catégories sociales, bousculade de codes musicaux et théâtraux. Tout ceci ressemble à l’antichambre de l’enfer, une antichambre certes joyeuse et festive, où l’on avance masqué. C’est à ne plus s’y retrouver.
L’enfer, peut-être, sera plus reposant.
Ce sont les femmes qui mènent la danse. Depuis Così fan tutte, on a vu de quoi elles étaient capables. Leurs sentiments ont été mis à nu, au-delà de la retenue sociale de convention. Celles-ci sont pareilles. A commencer par Donna Anna, la noble fiancée qui se fait (presque ?) violer dans sa chambre la veille de ses noces. Heureux trouble à l’ordre établi qui lui fait peur, goût d’une aventure perverse forcément consentie, et dont elle voudrait, d’ailleurs, retenir l’auteur et mieux le connaître. Donna Anna est jeune et craint de se laisser enfermer dans le carcan du mariage avec le pauvre Don Ottavio, son amoureux langoureux. Elle y viendra peut-être, au mariage, mais pas tout de suite. Avant cela, elle a besoin de vivre. La mort de son père (Père, Ordre, Commandeur, Principe) l’y autorise, paradoxalement.
Il y a ensuite, Donna Elvira. Une femme seule, abandonnée, amoureuse. Peut-être le seul amour véritable de Don Giovanni, celle à laquelle il aurait pu s’attacher mais qu’il a fuie, par peur, lui aussi, du mariage et de ses conventions (en ce sens Don Giovanni et Donna Anna se ressemblent, et je crois en leur complicité dans le meurtre du Commandeur). Elvira est une femme touchante par sa sensibilité, sa fidélité, la facilité avec laquelle son ardeur vindicative s’étiole au moindre mot d’espoir lâché par son ancien amant. Elle est sans doute d’une autre époque.
Enfin il y a la « petite » Zerlina, en fait la seule héroïne de l’histoire. C’est elle qui a compris avant tout le monde le personnage à qui elle avait affaire, et le parti qu’elle pouvait en tirer. D’un statut social inférieur aux nobles qui l’entourent, elle agit. En maîtresse, elle succombe à la séduction de Don Giovanni et y prend du plaisir. C’est à la fois une réjouissance sensuelle sans complexe et un désaveu des barrières sociales : en agissant ainsi, elle gagne un peu de noblesse, au grand dam de son fiancé Masetto qui n’a rien perdu de ses complots, mais s’avoue impuissant à les contrer. Elle est la femme agissante, peut-être celle qui est le plus tournée vers l’avenir et une certaine idée de la liberté féminine.
Face à cet agir des femmes, les hommes font pâle figure. Le personnage principal, Don Giovanni, focalise sur lui toutes les relations de désir sexuel et amoureux. Il fanfaronne, mais il fuit. Le catalogue de ses exploits – les fameuses « mille e tre » conquêtes énumérées par Leporello – est non seulement irréaliste, il me paraît aussi faux qu’un jeu de télé-réalité. En vérité, l’histoire de Don Giovanni, les histoires de Don Giovanni puisqu’il faut parler au pluriel, sont les histoires de nombreux échecs amoureux. Tentatives ratées, espoirs déçus, ponctués de quelques conclusions sans lendemain. Don Giovanni n’a rien à dire, rien à révéler de lui-même – pas un seul air digne de ce nom dans la partition, un comble pour le rôle-titre d’un opéra ! C’est un personnage en fuite, un voyageur, un nomade, à qui la seule idée de poser ses valises quelque part provoque la nausée. Qu’a-t-il avec l’idée d’ordre, de commandement, au point de lui faire la peau dès la première scène de l’ouvrage ? Don Giovanni est un anarchiste au sens étymologique, quelqu’un sans principe, sans boussole. Son insatiabilité sexuelle est le reflet de son incapacité à vivre quoi que ce soit dans la durée. Mais il brille, il se dore lui-même d’un éclat qui lui assure une certaine crédibilité. Au point qu’un homme, au moins, se laisse convaincre. Son valet Leporello, admiratif de son maître en dépit de tout l’inconfort que celui-ci lui fait subir (« Notte e giorno faticar »). Il songe. Ce n’est, après tout, qu’une question de hiérarchie : il est le perpétuel second, il se verrait bien le premier. Le projet de vie de Leporello est plutôt absurde : souffrant d’être l’esclave, il ne se rêve pas en affranchi (contrairement à Zerlina) mais en maître à la place du maître. Et quand le maître disparaît, il doit se chercher un autre maître… Et pourtant l’homme est attachant, il a la gouaille qui manque à son maître, il est l’opérateur de beaucoup de ses actions, même s’il n’en tire aucune gloire.
Masetto, quant à lui, est un homme du peuple épris de liberté. Mais ses actes n’ont pas le courage de ses dires : il fléchit devant la volonté de sa jeune femme qui le trompe le jour même de ses noces, et il a encore beaucoup à apprendre d’elle.
Don Ottavio, lui aussi, s’incline devant la volonté de sa future épouse : elle le fait attendre, et il attend. Il se lamente, c’est un sentimental, un vrai. Mais lui aussi s’avère incapable d’action, si ce n’est une démonstration de bravoure présumée dans la traque du criminel fugitif.
Je voudrais vivre cet opéra comme un chemin, non comme un état. Certes Don Giovanni est de notre époque, qui en douterait ? Certes Don Giovanni est d’ici et maintenant, mais aussi d’hier et de demain, et de là-bas. Je voudrais que la mise en scène fuie comme le personnage principal, qu’elle ne s’impose que par la mobilité et la dynamique qu’elle suscite. Et que jamais les choses ne semblent installées.
Frédéric Roels
![]()
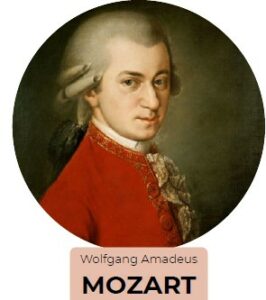
MOZART
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) est l’un des compositeurs les plus emblématiques de la musique classique occidentale. Né à Salzbourg, il révèle très tôt un génie musical exceptionnel. Enfant prodige, il compose dès l’âge de 5 ans et se produit dans les cours européennes avec sa soeur Nannerl, sous la direction de leur père, Léopold Mozart.
Mozart maîtrise tous les genres musicaux de son époque : symphonie, concerto, opéra, musique sacrée et musique de chambre. Il compose plus de 600 œuvres, dont certaines sont devenues des piliers du répertoire classique : Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Flûte enchantée, ses symphonies n°40 et 41, ainsi que ses concertos pour piano. Installé à Vienne à partir de 1781, il y connaît des succès artistiques mais aussi des difficultés financières. Son style allie clarté formelle, richesse harmonique et profondeur émotionnelle. Il excelle dans l’art de caractériser les émotions humaines, notamment à travers ses opéras, où il donne une voix singulière à chaque personnage.
Mozart meurt prématurément à 35 ans, laissant inachevé son célèbre Requiem. Son œuvre, d’une modernité saisissante, continue d’inspirer musiciens, chercheurs et mélomanes. Il incarne l’idéal du génie créateur, capable de sublimer les formes classiques tout en exprimant une humanité universelle.
 DON GIOVANNI
DON GIOVANNI
Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret de Lorenzo Da Ponte, créé à Prague en 1787. Qualifié de dramma giocoso, il mêle avec brio comédie, tragédie et fantastique, dressant le portrait d’un séducteur sans scrupules confronté à la justice divine.
L’histoire s’ouvre sur une tentative de séduction nocturne : Don Giovanni tente de séduire Donna Anna, mais est surpris par son père, le Commandeur, qu’il tue lors d’un duel. Donna Anna, bouleversée, jure de venger son père avec l’aide de son fiancé, Don Ottavio.
Don Giovanni poursuit ses conquêtes, accompagné de son valet Leporello, qui tient à jour un catalogue impressionnant de ses aventures amoureuses. Il croise Donna Elvira, une ancienne amante abandonnée, toujours éprise de lui, qui tente de le ramener sur le droit chemin. Il s’en prend ensuite à Zerlina, une jeune paysanne sur le point d’épouser Masetto, semant le trouble dans le couple.
Mais les victimes de Don Giovanni s’unissent : Donna Anna, Donna Elvira et Don Ottavio cherchent à le démasquer et à le punir. Malgré les avertissements, Don Giovanni persiste dans sa conduite immorale, défiant toute autorité, humaine ou divine. Le point culminant de l’opéra survient lorsqu’il invite, par provocation, la statue du Commandeur à dîner. Celle-ci accepte et, lors du souper, vient le chercher pour l’entraîner en enfer. Don Giovanni refuse de se repentir, et est englouti dans les flammes, dans une scène saisissante de justice surnaturelle.
L’œuvre se conclut sur une morale chantée par les autres personnages : « Tel est le sort de celui qui fait le mal. »
Don Giovanni est une œuvre magistrale, où Mozart allie profondeur psychologique, richesse musicale et tension dramatique. Le personnage-titre, à la fois fascinant et inquiétant, incarne l’orgueil humain face à la rédemption. L’opéra interroge la liberté, la responsabilité et la fatalité, dans une partition d’une intensité inégalée.
![]()
BIOGRAPHIES
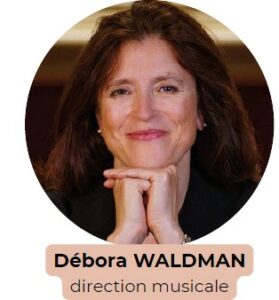
Debora Waldman
Cheffe d’orchestre franco-argentine-brésilienne, elle a grandi entre le Brésil, Israël et l’Argentine. À 17 ans, elle dirige pour la première fois et choisit la direction d’orchestre.
Formée au CNSMD de Paris, elle devient l’assistante de Kurt Masur à l’Orchestre National de France (2006-2009). En 2020, elle est nommée cheffe de l’Orchestre national Avignon-Provence, devenant la première femme à diriger un orchestre national permanent en France. Elle est aussi cheffe associée à l’Opéra de Dijon.
Engagée dans la transmission (projet Démos), elle fonde l’orchestre Idomeneo. Elle redonne vie à la symphonie oubliée de Charlotte Sohy, qu’elle enregistre avec l’Orchestre National de France. Son disque « Charlotte Sohy, compositrice de la Belle Époque » reçoit de nombreuses distinctions.
Elle dirige régulièrement en France et à l’international, dans les répertoires symphonique et lyrique, et prépare notamment Madame Bovary à Bruxelles et Cavalleria e Pagliacci à Dijon. Elle a dirigé également à Dijon en 2023 la cérémonie de remise des prix des Victoires de la musique classique, habillée par les petites mains de l’atelier de couture de l’Opéra Grand Avignon (NDLR).
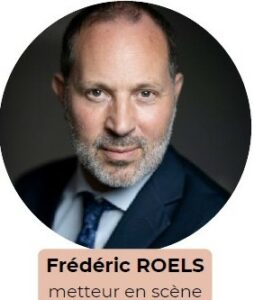
Frédéric Roels
Metteur en scène et directeur artistique belge, il dirige l’Opéra Grand Avignon depuis 2019. Il y impulse une programmation exigeante et ouverte, mêlant répertoire et création. Ancien directeur de l’Opéra de Rouen-Normandie, il y développe une politique d’inclusion et de formation, notamment avec une troupe de jeunes chanteurs. Il a également été directeur artistique au Royal Opera House de Muscat (Oman).
Metteur en scène reconnu, il signe des productions marquantes comme Carmen intime,Peter Grimes, Luisa Miller, Don Giovanni ou encore La Bohème, reprise en 2025 à Avignon dans une version épurée et poignante. Il y privilégie la lisibilité dramatique, la direction d’acteurs et la fidélité à la partition, tout en explorant la fragilité des personnages et la tension entre lumière et obscurité. Sa vision conjugue tradition et modernité, avec un engagement fort pour l’éducation artistique, la médiation culturelle et la création contemporaine.

Armando Noguera
Né en Argentine, citoyen français, Armando Noguera étudie au Teatro Colón puis à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Finaliste d’Operalia, lauréat des concours Francisco Vinas, Paris et Clermont-Ferrand, il reçoit les prix Carpeaux, AROP et Opera Chaser Award Australia.
Il débute au Teatro Colón dans Il Barbiere di Siviglia, Die Fledermaus et Dido and Aeneas.
Très demandé, il chante Monteverdi, Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Leoncavallo… Il se produit dans les grands théâtres français et internationaux, notamment à Paris, Glyndebourne, Venise, Rome, Québec, Baalbeck, et dans de nombreux festivals et concerts.

Gabrielle Philiponet
Née à Albi, Gabrielle Philiponet débute comme flûtiste et violoncelliste avant d’étudier le chant avec Daniel Ottevaere.
Lauréate de nombreux concours, dont le Concours Reine Elisabeth de Bruxelles, elle débute à l’Opéra de Paris dans Carmen. Elle incarne Micaëla, Leïla, Marguerite, Mireille, Lalla-Roukh, Antonia, Stella, Cendrillon, Solveig, Anitra, et Lilia. Elle chante Puccini (Magda, Lauretta, Mimì, Musetta), Donizetti (Adina), Rossini (Corinna), Verdi (Violetta, Desdemona, Alice Ford), Mozart (Donna Anna, Fiordiligi, Susanna, Despina).
Elle collabore avec Kent Nagano, Lorenzo Viotti, Alain Altinoglu, Hervé Niquet, entre autres, et se produit dans les plus grandes maisons d’opéra en France et à l’international.
En Vaucluse, nous l’avons entendue notamment dans La Bohème en 2025 et Musiques en fête en 2016 (NDLR).

Lianghua Gong
Ténor d’origine chinoise, Lianghua Gong se distingue par une carrière internationale en pleine ascension. Formé en Autriche, il est repéré dès 2011 par le Musikverein Graz comme jeune talent.
Il se produit dans des rôles majeurs tels que le Marquis von Châteauneuf dans Zar und Zimmermann, qu’il interprète en tournée avec le Landestheater Detmold en Allemagne et en Suisse.
Son répertoire couvre Mozart, Puccini, Verdi et des œuvres contemporaines, avec une présence remarquée sur les scènes européennes. Il collabore avec des maisons d’opéra et festivals renommés, affirmant une voix souple et expressive, saluée pour sa musicalité et sa sensibilité dramatique.
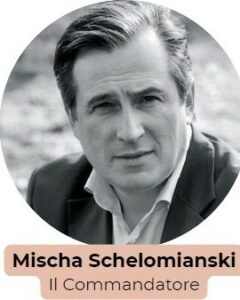
Mischa Schelomianski
Né à Moscou, Mischa Schelomianski étudie le chant à Francfort après une formation en ingénierie et culture. Il interprète des rôles majeurs tels que Sarastro, Osmin, Leporello, Grémine, Daland, Timur, Rocco, Wurm, Salieri, le Bailli, Baron Ochs, Boris Godounov, et Polkan.
Il se produit à l’Opéra national de Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, aux festivals de Glyndebourne et d’Aix-en- Provence, ainsi qu’à Munich, Vienne, Prague, Tokyo et Santiago.
Il chante avec des orchestres prestigieux comme l’Orchestre de Paris, le London Philharmonic et le Philharmonique Royal de Stockholm. En 2024-25, il incarne Séraphin/Plan dans Derborence, l’Esprit du Lac dans Rusalka à Marseille et Massy, et Frère Bénédictine dans Les Fiançailles au Couvent au Theater an der Wien.

Anaïk Morel
Originaire de Lyon, la mezzosoprano Anaïk Morel étudie le chant au CNSMD de Lyon auprès de Françoise Pollet. Lauréate de plusieurs concours, dont le Concours Pierre-Bernac et le Concours Reine Élisabeth, elle se perfectionne au studio de l’Opéra de Munich, où elle chante Fenena, Mercédès, Meg Page, Hansel, entre autres. Elle se produit ensuite à Berlin, Milan, Paris, Salzbourg, Zurich, Covent Garden, Aix-en-Provence, Toulouse, Stuttgart, Bâle, Hanovre… dans des rôles tels que Carmen, Preziosilla, Didon, Donna Elvira, Jocaste…
Elle collabore avec des chefs comme Barenboim, Equilbey, Petrenko, Roth, et des metteurs en scène comme Kosky, Sivadier, Tcherniakov…

Tomislav Lavoie
Originaire du Québec, Tomislav Lavoie débute comme violoniste au Conservatoire de Musique de Montréal avant de se consacrer au chant à l’Université de Montréal auprès de Mark Pedrotti et Marie Daveluy. Lauréat du titre de « Jeune ambassadeur lyrique », il reçoit le soutien de la Fondation Cédric Ferguson et des Jeunesses Musicales du Canada.
Il interprète Masetto, Figaro, Don Alfonso, Basilio, Méphistophélès, Sarastro, Melchtal, Barbe-Bleue, entre autres. Il chante à l’Opéra national de Paris, Opéra-Comique, Opéra de Lyon, Cologne, Genève, Montréal, Amsterdam, Wexford, Versailles, Avignon, et au Théâtre des Champs-Élysées. Il collabore avec des chefs tels que Tugan Sokhiev, Yannick Nézet-Séguin, Marc Minkowski et Raphaël Pichon dans un répertoire allant de Gluck à Lavandier.

Aimery Lefèvre
Baryton français, Aimery Lefèvre débute par l’étude du piano, de l’orgue et du chant avant d’intégrer la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il poursuit sa formation au CNSM de Lyon, où il remporte plusieurs prix, puis rejoint l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris.
Il fait ses débuts en 2005 et se produit depuis avec les plus grands ensembles et sur les scènes majeures. En 2009, il chante à l’Opéra de Paris dans Le Barbier de Séville et Platée.
Sa tessiture de baryton lui permet d’aborder un vaste répertoire, du baroque au contemporain, avec une voix chaleureuse et une présence scénique affirmée.

Eduarda Melo
Soprano portugaise, Eduarda Melo est lauréate du 2ᵉ prix au Concours International de Chant de Toulouse. Formée à l’ESMAE de Porto et au Studio d’Opéra de la Casa da Música, elle débute à l’international avec le CNIPAL à Marseille. Elle chante sur les scènes de France et du Portugal dans des rôles tels que Rosina, Norina, Musetta, Despina, Constance, Frasquita, Valencienne, Corinna, Stéphano, Gabrielle, Zemina, Vespina, Elle(La Voix humaine), et Maria Luisa.
Elle participe à des créations contemporaines de Pinho Vargas, Nuno Côrte-Real et Luís Tinoco.
En concert, elle interprète Mozart, Poulenc, Brahms, Berio, Berg et Almeida. Elle collabore avec Marc Minkowski, Antonello Allemandi, Laurence Cummings, Franck Ollu, et les ensembles Divino Sospiro et Ludovice Ensemble.
(A Avignon, nous l’avons entendue dans Don Giovanni [le film] en 2021, dans Three lunar seas en 2023, et Les Folies amoureuses en 2025. NDLR).

Le Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Le Chœur de l’Opéra Grand Avignon est composé de 20 artistes permanents, et travaille régulièrement en formation élargie selon les exigences des productions lyriques et des concerts. L’éventail des styles abordés exige une musicalité et une souplesse exceptionnelle de technique vocale en chœur. Les artistes du Choeur de l’Opéra prennent part à l’ensemble de la saison lyrique de l’Opéra Grand Avignon, en collaboration avec l’Orchestre national Avignon-Provence et d’autres formations. Ils sont aussi au centre de nombreuses actions pédagogiques et de médiation : concerts conçus pour les publics éloignés, répétitions ouvertes, rencontres métiers…
Ils sont régulièrement invités aux Chorégies d’Orange et plus récemment, pour la première fois au Festival d’Aix-en-Provence pour Les Pêcheurs de Perles de Bizet, dirigé par Marc Minkowski.
Depuis le 1er janvier 2024, le Choeur de l’Opéra Grand Avignon est dirigé par Alan Woodbridge, chef de chœur franco-britannique. Il a travaillé avec English National Opéra, Opéra national de Lyon, et Le Grand Théâtre de Genève, mais également avec le Chœur de Radio France, du Dutch National Opera, de l’Opéra de Dresden, et le Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor au Festival de Salzburg. Il y sera invité une nouvelle fois cet été à diriger les chœurs des productions de Macbeth de Verdi avec Philippe Jordan, Maria Stuarda de Donizetti avec Kate Lindsey et Lisette Oropesa, et Andrea Chénier de Giordano avec Marco Armiliato.
Alan Woodbridge a participé à nombreux enregistrements avec EMI, Erato, Mezzo et Arte en qualité de chef de Chœur : Doktor Faust, L’Elisir d’amore, La Sonnambula, Lohengrin, Les Contes d’Hoffmann, The Rake’s Progress, La Damnation de Faust, Atys, Les Indes galantes, Didon et Énée… et les récitals avec Joyce Di Donato et Juan Diego Florez. Il est Chevalier des Arts et des Lettres – République française.
Laisser un commentaire